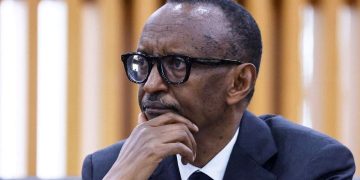Tous les sept ans, les villages sénoufos vibrent au rythme du « Kafouho », une cérémonie hautement symbolique qui marque la fin du long parcours initiatique du Poro, institution sacrée au cœur de la société sénoufo.
Le « Kafouho » débute traditionnellement entre juillet et août, selon les villages du Gbatoh, notamment à Linguédougou, Gbatosso, Yérétiélé, Lokolo, etc. Il se tient dans le Kafigue et d’autres localités de Korhogo en fonction de leur calendrier. Il sanctionne la fin de sept années de formation intense dans la forêt sacrée, où les jeunes initiés apprennent les valeurs, les savoirs et les secrets qui structurent la vie communautaire.
Au centre de ce rite se trouve la vieille détentrice du bois sacré, appelée Maliew ou Katcheliew selon les sous-groupes sénoufos. C’est elle qui donne l’autorisation aux jeunes jugés aptes de chanter et de s’exprimer publiquement. Lors de la cérémonie, le Katcheliew coiffe solennellement les initiés qui ont obtenu leur secam, symbole de leur accomplissement.
Dans une ambiance festive, ces jeunes hommes se parent de vêtements féminins, se maquillent, portent des bijoux et des boucles d’oreilles. Ainsi travestis, ils chantent et dansent pour révéler au grand jour les enseignements tirés de leur apprentissage. Leurs chants, souvent empreints de poésie et de sagesse, relatent leurs expériences vécues dans la forêt sacrée, tout en prodiguant des conseils à la communauté et en rappelant les valeurs de solidarité, de respect et de courage.
Le « Kafouho » dépasse la dimension rituelle pour devenir un moment de cohésion sociale et culturelle, où se mêlent tradition, spiritualité et fête populaire. C’est aussi une occasion de transmission intergénérationnelle, puisque les aînés, à travers ces cérémonies, rappellent aux plus jeunes l’importance de préserver l’héritage du Poro.
Véritable pilier de l’identité sénoufo, le « Kafouho » reste, encore aujourd’hui, un marqueur fort de l’attachement des communautés à leurs valeurs ancestrales. Soulignons que les femmes initiées ont droit aussi au « Kafouho » sauf qu’elles ne chantent pas comme les hommes. Toutefois, c’est une joie partagée.
Karina Fofana